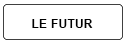À l’heure actuelle, il faut que les surfaces vitrées soient dimensionnées et placées de telle sorte que les espaces intérieurs soient baignés de lumière, mais sans chaleur excessive. Pour éviter de consommer des quantités astronomiques d’énergie pour le refroidissement, des décisions architecturales importantes doivent être prises très tôt. Il est toutefois rare de pouvoir se passer totalement de la technique du bâtiment, surtout en cas de charges internes élevées.
Texte: Remo Bürgi
Les grandes fenêtres sont prisées. Rien de surprenant: elles laissent pénétrer une grande quantité de lumière du jour dans les espaces intérieurs et offrent une vue sur l’extérieur. La quantité importante de vitrage présente toutefois un inconvénient, car les rayons du soleil peuvent entraîner une chaleur excessive. Faudrait-il à nouveau avoir recours à des fenêtres plus petites? Non! Disposer de moins de lumière du jour serait non seulement très impopulaire mais aussi potentiellement nocif. À ce jour, nous pouvons certes remplacer la lumière du jour par de la lumière artificielle, mais ceci uniquement d’un point de vue visuel. Le soleil est non seulement une source de lumière, mais il a également une influence sur notre organisme. Il est prouvé qu’un manque de lumière du jour a un effet négatif sur la santé humaine. Cela s’explique par le fait que le rythme circadien du corps humain est essentiellement rythmé par la lumière du soleil. Si ce contact fait défaut, le rythme est perturbé, ce qui peut entraîner des maladies telles que la dépression, le diabète, les maladies cardiaques ou le cancer.
Prévoir suffisamment de lumière du jour
Il est par conséquent important de concevoir les bâtiments de manière à ce que les utilisateurs bénéficient le plus possible de la lumière du jour. La norme européenne SN EN 17037 « Lumière naturelle dans les bâtiments » fait office de base obligatoire en Suisse depuis 2019. Elle définit des critères de qualité, par exemple en matière de protection contre l’éblouissement, d’ensoleillement ou de vue sur l’extérieur. Cela permet à la « bonne lumière » de devenir tangible.
Pour obtenir l’apport de lumière naturelle requis, la surface des fenêtres est certes un facteur important, mais il est loin d’être le seul (voir graphique). Les points de départ architecturaux importants sont par exemple aussi:
- les proportions des espaces: les pièces hautes offrent un meilleur apport de lumière naturelle en profondeur.
- la hauteur de linteau: plus la hauteur du linteau au-dessus de la fenêtre est faible, plus la lumière pénètre à l’intérieur de la pièce.
- les zones d’ombre: les auvents, les balcons ou les bâtiments voisins peuvent faire de l’ombre aux surfaces vitrées et réduire ainsi la pénétration de la lumière du jour.
En outre, l’orientation du bâtiment joue bien sûr un rôle décisif, les façades orientées au sud recevant mieux la lumière du jour que celles orientées au nord.

Garantir la protection contre la chaleur en été
Des fenêtres ressemblant à des meurtrières ne peuvent donc pas être la solution choisie pour prévenir la chaleur excessive des espaces intérieurs. Il faut au contraire considérer le problème dans son ensemble. Lorsque la lumière du soleil entre en contact avec une surface vitrée, l’espace situé derrière est beaucoup plus chauffé que si des parties de la façade sont opaques, surtout si celles-ci sont bien isolées. Pour éviter que le bâtiment ou des pièces isolées soient surchauffés, il faut en premier lieu empêcher l’incidence directe des rayons du soleil sur le verre. Pour cela, on installe généralement une protection solaire extérieure, comme des stores à lamelles, des marquises ou des volets roulants. Cette protection solaire extérieure est conçue de manière optimale pour que la lumière du jour puisse tout de même pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Pour éviter d’éblouir les utilisateurs, elle est souvent combinée avec une protection contre l’éblouissement installée à l’intérieur.
Les aspects architecturaux font également partie d’une protection complète contre la chaleur estivale. En font notamment partie:
- Fenêtres d’angle: Elles apportent certes beaucoup de lumière naturelle, mais présentent aussi un grand risque de surchauffe. C’est pourquoi les surfaces vitrées des pièces d’angle devraient, dans certains cas, être limitées à un seul côté de la façade.
- Allège: Pour l’apport de lumière naturelle, c’est surtout la lumière entrant par le haut dans la pièce qui est importante. Il peut donc être judicieux de ne pas concevoir les fenêtres au ras du sol, mais de prévoir une allège. Cela réduit nettement plus l’apport de chaleur que l’apport de lumière du jour.
- Ombrages fixes: Utilisés de manière ciblée, les balcons ou les auvents offrent une protection solaire efficace pour les fenêtres situées en dessous.
- Masse de stockage: Les sols, les murs et les plafonds s’opposent au réchauffement lorsqu’ils ne sont pas recouverts d’un habillage. Pour cette raison, il faut dans la mesure du possible renoncer aux plafonds suspendus et ne pas enduire les murs ou les enduire uniquement avec des matériaux appropriés.
- Charges internes: Les appareils produisent de la chaleur. Il convient donc d’utiliser des éclairages LED et des infrastructures informatiques efficaces sur le plan énergétique, qui chauffent le moins possible les espaces intérieurs.

La Technique du batiment quand les charges internes sont élevées
L’expérience montre que ces différentes approches permettent déjà d’améliorer sensiblement la protection contre la chaleur en été. En particulier pour les bâtiments dont les charges internes sont élevées (p. ex. bâtiments administratifs ou scolaires équipés de nombreux appareils informatiques et fréquentés par un grand nombre d’utilisateurs). Compte tenu des étés de plus en plus chauds avec des périodes de canicule prolongées, de plus en plus de bâtiments auront besoin d’un système de refroidissement, sans quoi la chaleur ne pourra plus être évacuée du bien immobilier. Il existe certes des concepts low-tech qui, grâce à une maçonnerie massive par exemple et à un pourcentage de fenêtres très bas, ne nécessitent pas de refroidissement actif. Cela nécessite toutefois une architecture spécialement conçue à cet effet, ce qui n'est guère réalisable a posteriori, en particulier pour les bâtiments existants.
Différentes méthodes de refroidissement
Il est possible de rafraîchir les bâtiments de diverses manières. Le rafraîchissement nocturne ne nécessite en général aucune technique ni énergie. Pour ce faire, les fenêtres sont ouvertes la nuit de manière à ce que la chaleur soit évacuée par une ventilation transversale (horizontale) ou par effet de cheminée (verticale). Mais ceci fonctionne uniquement si la température extérieure chute la nuit en-dessous de la température interne des locaux. En cas de périodes de chaleur avec des nuits tropicales, la méthode atteint donc ses limites.
Le free cooling est une alternative utilisant peu d’énergie et qui consiste à faire circuler de l’eau froide dans des conduites placées dans le sol ou dans le plafond. Cette méthode permet d’absorber la chaleur et de la transmettre à un puits de chaleur comme une nappe phréatique ou des sondes géothermiques. Seule la pompe de circulation de la pompe à chaleur nécessite de l’énergie dans ce processus. La température interne ambiante peut être réduite de quelques degrés grâce à cette méthode. Si cela ne suffit pas, par exemple si les charges internes sont trop élevées, un refroidissement actif par une machine produisant du froid est nécessaire. L’idéal est d’utiliser sa propre électricité photovoltaïque provenant du toit et/ou de la façade pour l’alimenter. La plupart du temps, les pics de production du photovoltaïque coïncident avec les pics de demande de refroidissement, les deux se situant généralement à midi les jours d’été ensoleillés.

Le compertement des utilisateurs est décisif
On oublie souvent qu’en plus des paramètres architecturaux et des solutions techniques, les utilisateurs jouent eux aussi un rôle central dans l’efficacité de la protection contre la chaleur estivale.
Leur comportement détermine si les concepts envisagés fonctionnent effectivement dans la pratique. Cela vaut en particulier pour le comportement d’aération et l’utilisation de la protection solaire. Si les utilisateurs ouvrent les fenêtres à des moments inopportuns ou oublient d’actionner l’ombrage extérieur, le confort climatique souhaité ne sera guère atteint. Il est donc important d’instruire soigneusement les utilisateurs. Néanmoins, dans le contexte du changement climatique, l’automatisation des bâtiments devrait également gagner en importance à l’avenir dans les bâtiments d’habitation. Les planificateurs devraient tenir compte de cet aspect et en discuter avec le maître d’ouvrage et les architectes, afin que les bâtiments fonctionnent comme souhaité, même dans le climat de demain.
Planifier en temps utile
Afin de désamorcer les conflits d’objectifs entre la lumière naturelle et la protection contre la chaleur estivale, il convient d’examiner et d’intégrer différents aspects. Il est essentiel d’en tenir compte dès les premières phases de planification. Les simulations thermiques des bâtiments constituent une aide précieuse à cet égard. Elles montrent par exemple dans quelles pièces il y a un risque de chaleur excessive. De plus, elles permettent d’envisager différents projets et de développer des variantes.
Ces articles pourraient également vous intéresser
Mentions légales
Source du texte: Remo Bürgi
Source de l'image: Pixabay
Informations
Autres articles
Veröffentlicht am: