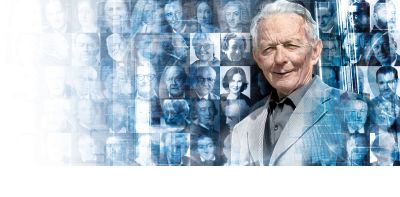Les voitures et les camions sont déjà équipés de moteurs à hydrogène avec des piles à combustible. L’application de cette forme de production d’électricité pour des machines de chantier, des bateaux ou des avions à propulsion électrique nécessiterait des piles à combustible à la fois très puissantes et légères. Une entreprise romande travaille sur une solution innovante en collaboration avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (sur le site de Sion/VS).
Auteur: Benedikt Vogel, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
Photos: mis à disposition
La Hyundai Nexo et la Toyota Mirai sont actuellement les deux véhicules à hydrogène fabriqués en série. Leurs moteurs électriques sont alimentés par de l’électricité produite par des piles à combustible d’une puissance d’un peu plus de 100 kilowatts. Certains constructeurs de camions et de bus ont également lancé différents véhicules électriques dans lesquels l’électricité pour les moteurs est générée par «combustion froide», c’est-à-dire par la conversion directe de l’hydrogène dans une pile à combustible. Même si les véhicules électriques à batterie sont beaucoup plus répandus aujourd’hui, il existe des applications pour lesquelles les véhicules à hydrogène représentent une alternative intéressante, car l’hydrogène comprimé permet de stocker de grandes quantités d’énergie.
«Les piles à combustible sont déjà utilisées dans de nombreuses applications mobiles, mais le potentiel d’amélioration est encore présent. Nous travaillons sur des piles à combustible de grande puissance, jusqu’à un mégawatt, légères, compactes et robustes et, par conséquent, utilisables dans des véhicules de chantier, des bateaux et des avions», explique Mardit Matian, directeur de l’entreprise EH Group Engineering à Nyon (VD).
L’ingénieur a fondé sa propre entreprise, EH Group, en 2017, celle-ci compte aujourd’hui 18 collaborateurs et livre des prototypes à ses premiers clients. En 2022, la jeune entreprise a présenté le concept d’un système de piles à combustible (voir encadré 1) d’une puissance de 250 kilowatts. Depuis, ce système est devenu un prototype soutenu par un projet de recherche de l’OFEN.
Piles à combustibles avec cellules PEM moins épaisses
Pour comprendre l’innovation de la start-up romande, il suffit jeter un coup d’œil à l’intérieur d’une pile à combustible dite PEM, telle qu’elle est utilisée aujourd’hui, de préférence pour des applications mobiles. PEM signifie «Proton Exchange Membrane», membrane échangeuse de protons en français. La membrane qui donne son nom à la pile à combustible PEM est la pièce maîtresse: elle maintient les deux gaz, l’hydrogène et l’oxygène, à l’écart l’un de l’autre, mais elle est perméable aux ions d’hydrogène (protons) qui se forment lorsque les molécules d’hydrogène cèdent leurs électrons à l’anode.
Les protons se diffusent de l’anode vers la cathode à travers la membrane, tandis que les électrons circulent de l’extérieur vers la cathode via une charge (un moteur électrique dans les applications de mobilité). Sur la cathode, les protons et les électrons qui arrivent forment de l’eau par réaction avec l’oxygène alimenté.
Les deux réactions partielles requièrent une couche de catalyseur des deux côtés de la membrane, laquelle forme, avec la membrane, ledit assemblage membrane-électrodes (Membrane electrode assembly, MEA). Une couche de diffusion de gaz (Gas diffusion layer/GDL), qui contient une couche microporeuse (Microporous layer/MPL), est adjacente des deux côtés (voir fig. 01). Le projet de recherche de l’OFEN, intitulé EHSTACK-XL, s’est concentré sur les couches GDL et MPL. Dans une pile à combustible typique, ces deux couches ont une épaisseur de 180 à 400 micromètres. Au cours du projet EHSTACK-XL, cette épaisseur a été réduite à moins de 100 micromètres. Parallèlement, la diffusion de l’eau et des gaz à travers les couches MPL/GDL a été améliorée.